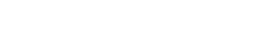Un plat à « Barbe à Papa » pour la fête des pères
Samedi 15 juin 2024 à 07h
Cette semaine, Mylène du Loir-et-Cher, nous confie l’expertise d’un plat à barbe. L’occasion pour notre commissaire-priseur, Aymeric Rouillac, de féliciter tous les papas dont est célébrée la fête ce dimanche.

Expression d’un style, reflet d’une personnalité, la barbe orne aujourd’hui de nombreux visages masculins, mais qu’en était-il au XVIIIe siècle ? Ce plat à barbe nous en dit plus. En faïence aux côtés chantournés lui donnant une forme de coquille, cette cuvette est ornée d’un décor polychrome. Le plat en terre, d’abord moulé, est cuit une première fois entre 900 et 1000 degrés. Il est ensuite plongé dans un bain d’étain, rendant la surface blanche et opaque, sur laquelle le faïencier trace son décor à main levé. Une deuxième cuisson, autour de 1200 degrés permet de fixer le décor et rendre le plat imperméable.
Le décor figure au centre une grue poursuivant un papillon dans un jardin exotique figurant un palmier imaginaire. Le pourtour est orné de feuillages stylisés scandés par un double liseré et bordé d’un filet noir et un liseré bleu. Ce motif naïf, tracé à la main, est assez répandu dans toute la production usuelle et n’est pas spécifique à notre plat. La couleur rouge de la terre, visible sur le dessous du talon non émaillé, permet de rapprocher cette pièce de la production du Sud de la France, son décor ressemblant notamment à la production de Moustier, petit village des Alpes-de-Haute-Provence. Le talon du plat est percé de deux trous reliés par une cordelette de façon à le suspendre au mur. L’inscription « Le Maynard » au revers n’est pas répertoriée. Elle est probablement la signature d’un faïencier amateur. Le décor, assez succinct, la forme et l’état de conservation de ce plat à barbe laissent à penser qu’il s’agit d’une pièce décorative du XXe siècle.
En effet, les plats à barbe en forme de cuvette ont une échancrure dite « mentonnière » au centre, de façon que le barbier y place le menton de son client, puisse le savonner et y recueille la mousse. Votre plat Mylène semble quelque peu disproportionné. L’échancrure large et peu incurvée incline à y trouver une fonction décorative et non usuelle. Par l’ondulation de ses côtés, ainsi que son motif de grue aux relents asiatiques, le plat s’inspire de la production dite « rocaille » du milieu du XVIIIe siècle, âge d’or de la faïencerie et du rasage en France. A cette époque, l’usage veut que les hommes se rasent tous les jours. Les gentilshommes possédaient leur propre plat et recevaient leur barbier dans leur cabinet de toilette. Le barbier d’antan ne se contentait pas de raser la barbe de ses clients : il était en charge de l’entretien global du poil, cheveux et perruques compris. Il réalise également des opérations de petite chirurgie. Le barbier est ainsi le second personnage de la chambre du roi, emploi noble réservé à un homme de grande confiance de par sa proximité avec le corps royal.
Si les plats à barbe ont du succès auprès des collectionneurs, celui-ci n’est pas d’époque. Réalisé récemment, il présente un intérêt historique et décoratif restreint. Présenté aux enchères, il pourrait trouver preneur autour de 40 euros ; un cadeau accessible pour les enfants qui chercheraient une idée pour la fête des pères. En effet, si la barbe ne fait pas le philosophe, ce plat pourrait, lui, faire un heureux !